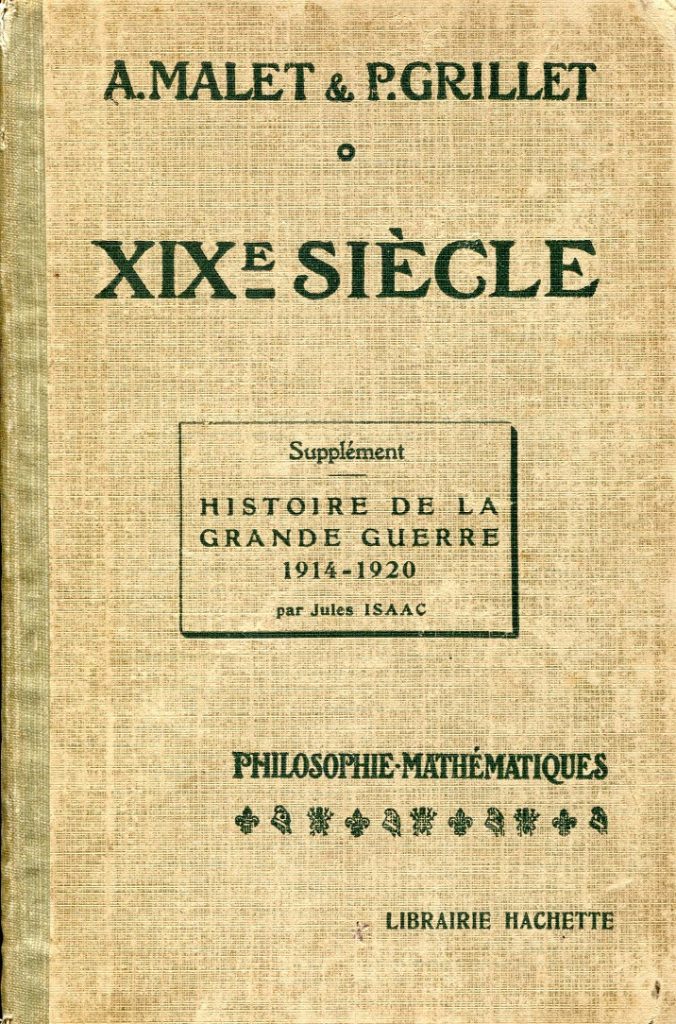Rémy Cazals, 2021
Des combattants de la Grande Guerre, témoins très bien classés par Jean Norton Cru, ont vivement critiqué les historiens qui étaient leurs contemporains. Dans un article de la revue Europe de juin 1923, Léon Werth jugeait que la science de l’historien était « malade » : « La guerre lui a porté un coup. Ils sont tous à enseigner l’histoire, tranquillement, sur la foi des textes. Ils ont assisté à une magnifique expérience de cinq ans. Et pas un n’a songé à confronter aux faits les textes qui servent à fabriquer l’histoire. Admirable méthode cependant pour vivifier la critique des textes du passé. Et comme ils auraient ainsi facilité la tâche des historiens de l’avenir ! » Dans une lettre de juin 1936 adressée à Jules Isaac, André Pézard avoue être passé au lendemain de la guerre par une phase où il a « maudit en bloc les historiens ». Bien après la publication de Témoins, le « combattant pacifiste » Camille Rouvière répond aux officiers qui se plaignent que le livre de Barbusse les ignore : « À vous, messieurs les officiers : tous les académiciens, tous les évêques du bon Dieu, et tous les historiens ! À nous : rien que ce Feu. À nous, rien que Barbusse. »
Jean de Pierrefeu est monté en généralité en faisant de Plutarque le prototype des historiens bourreurs de crânes. Un des premiers chapitres de JNC lui-même constitue une dénonciation des faiblesses de l’histoire militaire avant 1914, et, dans ses notices, il s’en prend aux historiens de son temps qui choisissent les témoins peu fiables pour illustrer leurs ouvrages prétendument savants.
Cette partie évoquera successivement les historiens ayant combattu en 1914-1918, l’utilisation des témoignages dans les livres d’histoire, et l’attitude des historiens ayant contribué à l’édition de témoignages.
1. Le témoignage des historiens combattants de 14-18
Le cas Pierre Renouvin
Pierre Renouvin (1893-1974) est un vrai combattant de la Grande Guerre ; blessé au Chemin des Dames, amputé d’un bras, il en a gardé sur lui la trace traumatique. À ma connaissance, il n’a pas publié de témoignage personnel, mais sa correspondance de guerre a dû exister. Son grand livre de 1934, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, en était en 1969 à sa cinquième édition, revue et augmentée, dans la prestigieuse collection « Peuples et Civilisations » des Presses universitaires de France. Le livre développe les aspects militaires, diplomatiques, économiques, sociaux, politiques. Il utilise et donne en références les mémoires des Grands, en particulier des généraux des diverses nations belligérantes, mais pas du tout les témoignages des soldats. L’expérience combattante n’a pas sa place dans cet ouvrage universitaire de premier plan.
Pour une évocation rapide des témoignages publiés, il faut aller tout à la fin du livre, au dernier chapitre de la dernière partie, « Le mouvement intellectuel ». Dans ce qui ressemble à un catalogue, il examine trois domaines : I. Les sciences ; II. Les lettres ; III. Les arts. Par « lettres », il ne faut pas comprendre « correspondances », mais « œuvres littéraires ». Après le roman, le théâtre, la poésie, et avant la philosophie et l’histoire, il note que la guerre a « ouvert l’ »ère du témoignage ». Dans tous les pays belligérants, la « littérature de guerre » a été abondante. Par centaines ont été publiés les souvenirs des combattants, les carnets de route ou les lettres. » Pierre Renouvin estime qu’il s’agit d’une « production de circonstance » ; à propos de plusieurs de ces auteurs, j’ai employé plus haut l’expression « notables profitant d’un marché éditorial » (voir la troisième partie de ces réflexions). Pour Renouvin, la plupart de ces livres sont « sans valeur littéraire proprement dite ». « Rares sont celles de ces œuvres qui ont survécu à un succès éphémère » : il s’agirait de Duhamel, Barbusse, Dorgelès et Remarque ; aucune mention de Genevoix, de Pézard, des auteurs placés par JNC en première catégorie pour la valeur de leur témoignage. On voit ainsi ce que représentent « les lettres » pour Renouvin.
En 1948, Pierre Renouvin dirigea la thèse d’un ancien officier subalterne de 1915, lui-même amputé de l’avant-bras gauche. Titre de la thèse : La pensée militaire allemande. L’auteur, Eugène Carrias, avait noté ses souvenirs de combattant de la Première Guerre mondiale, des pages non destinées à la publication, mais qui ont fourni la matière du livre Souvenirs de Verdun, Sur les deux rives de la Meuse avec le 164e RI, des éditions C’est-à-dire de Forcalquier, présenté par Emmanuel Jeantet en 2009.
Jules Isaac
Jules Isaac (1877-1963) était déjà agrégé d’histoire et auteur de manuels de la collection qui deviendra « Malet-Isaac » chez Hachette. Mobilisé au 111e RIT, il a été blessé sous un bombardement en juin 1917. L’association des Amis de Jules Isaac conserve 1800 lettres écrites du front à sa femme et en a publié une sélection sous le titre Un historien dans la Grande Guerre, lettres et carnets (Armand Colin, 2004). On peut consulter le corpus intégral à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence.
Ses lettres sont celles d’un vrai poilu décrivant les conditions de vie dans les tranchées, la tension nerveuse, l’extraordinaire capacité d’adaptation des hommes à des situations inhumaines, la haine de la bourgeoisie « pépinière des embusqués » et la critique des bourreurs de crâne produisant des vérités « pour salons académiques et sacristies distinguées ». Il a surtout souligné l’immense désir de paix des soldats. Il n’aime pas Barrès. Il pense que son collègue historien Lavisse qui écrit sur la guerre devrait être éclairé car il a perdu tout sens des réalités. Jules Isaac reste patriote et estime qu’il faut détruire le militarisme allemand, sans que s’imposent de nouveaux militarismes.
L’historien a-t-il fait passer son témoignage personnel dans ses ouvrages d’après-guerre ? En 1921, il a publié en 125 pages un supplément au manuel des classes terminales d’avant 1914, sous le titre Histoire de la Grande Guerre 1914-1920. On est obligé de constater que, juste après la fin du conflit, de fortes contraintes ont pesé sur l’auteur de manuels de très large diffusion. L’opinion publique et les autorités n’auraient pas accepté autre chose que l’affirmation des seules responsabilités de l’Allemagne et de ses alliés dans le déclenchement de la guerre ; il fallait aussi traiter longuement des atrocités contre les civils en Belgique et dans les départements français occupés. Le manuel ne contient aucune critique des généraux français ; il ne signale pas de crise du moral, pas de mutineries ni de fraternisations. Le déroulement des batailles est développé, illustré de croquis, comme dans le cas des guerres des deux Napoléon du siècle précédent. Aucun témoignage de soldat n’est cité. Si le manuel de 1921 porte témoignage, c’est sur les pressions exercées sur son rédacteur par l’ambiance chauvine de l’immédiat après-guerre.
Les années passent. Le Malet-Isaac des années 30 prend du recul et nuance les positions excessives de 1921. Jules Isaac a lu Jean Norton Cru et a fait un compte rendu favorable de Témoins : « un guide indispensable, bien que la sévérité de ses jugements ne soit pas sans appel ». Il écrit nettement : « On ne peut connaître toute la réalité de la guerre que par les témoignages des combattants. » Et il conseille la lecture des deux anthologies, celle de JNC lui-même dans Du témoignage, et celle d’André Ducasse. Le manuel des années 50 va plus loin encore en citant les noms des auteurs les mieux classés par JNC.
Marc Bloch
Fils d’historien, Marc Bloch (1886-1944), était en train de rédiger sa thèse de doctorat lorsqu’il fut mobilisé comme sergent d’infanterie en août 1914. Il était capitaine en 1918. Ses Écrits de guerre ont été réunis sous ce titre en 1997 chez Armand Colin, déjà éditeur de ses ouvrages universitaires, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française et Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien.
Cette réunion de textes comprend : des notes laconiques confiées à des carnets ; des souvenirs rédigés pendant une convalescence en 1915, « avant que le temps n’efface leurs couleurs aujourd’hui si fraîches et si vives » ; quelques lettres ; des rapports officiels écrits pour le compte de son colonel ; des listes de livres à lire. En 30 pages, la longue introduction de Stéphane Audoin-Rouzeau dit tout ce qu’on va trouver dans le livre et dispenserait presque de lire Marc Bloch, ce qui est regrettable, comme on l’a montré plus haut avec d’autres exemples.
Parmi les livres référencés par Marc Bloch, certains ont été utilisés pour compléter son expérience personnelle et écrire l’article « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » paru en 1921 dans la Revue de synthèse historique. Cet article est repris dans les Écrits de guerre. Si l’on peut ajouter un complément d’information sur ce thème, il faut citer le témoignage du sergent Pomiro, publié en 2006 par Privat (Les Carnets de guerre d’Arnaud Pomiro, Des Dardanelles au Chemin des Dames) : cet instituteur a noté scrupuleusement, presque chaque jour, les rumeurs qui circulaient dans la troupe, dans une rubrique « Bruits » spécialement créée.
Les livres de Ducasse, Meyer, Perreux
La Biffe, témoignage direct du lieutenant Jacques Meyer publié en 1928, figure dans la première catégorie de JNC. L’anthologie préparée par André Ducasse date de 1932 ; elle complète et conforte les travaux de JNC. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1959, ces deux normaliens agrégés de l’Université, associés à un camarade de la même promotion, lui aussi ancien combattant (Gabriel Perreux), ont publié chez Hachette le livre Vie et Mort des Français 1914-1918, préfacé par celui que JNC place en première position parmi les témoins, Maurice Genevoix. Le livre répondait au souhait formulé par André Ducasse dans son anthologie : « Si l’on veut que les générations futures ne s’en tiennent point à « un maquillage sans vergogne », il est temps de réagir, de revenir aux meilleurs historiens de la guerre : les combattants. » Et le livre des trois camarades donnait largement la parole aux meilleurs témoins.
Le succès du livre incita le même éditeur à confier à deux de ces auteurs la rédaction de volumes sur 14-18 dans la belle collection « La Vie quotidienne ». Gabriel Perreux traita des civils ; Jacques Meyer, des soldats, un livre ouvert sur une citation tirée des Commentaires de Montluc : « Les historiens n’escrivent qu’à l’honneur des rois et des princes. Combien de braves soldats et gentils hommes ai-je nommés ici-dedans, desquels ces gens ne parlent du tout, non plus que s’ils n’eussent jamais esté. »
Remarquons toutefois que ces ouvrages furent édités avant la grande vague de découverte et de publication des œuvres des témoins d’origine populaire. Dans une collection reprenant la thématique abandonnée par Hachette, les éditions Cairn de Pau ont confié à Rémy Cazals et André Loez la rédaction d’un titre sorti en 2008 : La vie au quotidien… Dans les tranchées de 1914-18. Le livre cite cent cinquante témoins, pour la plupart récemment publiés ou inédits. Il a été réédité par Tallandier dans la collection de poche « Texto » en 2012. Répondre au souhait de Ducasse, Meyer et Perreux impliquait de poursuivre dans la même voie en dépassant ce que l’on pouvait faire en 1959 et dans les années 60.
Charles Delvert
Lui aussi normalien et agrégé d’histoire, Charles Delvert (1879-1940) a commencé la guerre comme lieutenant d’infanterie ; il a combattu notamment en Champagne et à Verdun et a servi dans des états-majors à partir d’août 1916. Ce dernier poste lui a permis d’écrire L’erreur du 16 avril 1917, paru en décembre 1920. Son témoignage personnel, Histoire d’une compagnie (Berger-Levrault, juillet 1918), est longuement analysé par JNC qui place Delvert dans sa première catégorie.
JNC a pu comparer le texte édité avec le carnet tenu dans les tranchées par le lieutenant historien. Il en conclut que « les livres de certains combattants, celui de Delvert en particulier, sont la reproduction presque textuelle de leurs carnets ». Ce carnet, Delvert l’a prêté à l’écrivain Henry Bordeaux pour des articles de la Revue des Deux Mondes ; celui-ci l’a utilisé en lui faisant subir « un travail d’adaptation au goût du public d’où il sort émasculé, travesti et dénaturé ». JNC ajoute : « Il est regrettable aussi que la version de Bordeaux soit connue par un bien plus grand nombre de lecteurs et de critiques que la version originale de Delvert. Ce fait contribue à maintenir dans l’ombre le mérite d’un des meilleurs écrivains combattants. »
La conclusion de la notice « Delvert » dans Témoins doit enfin être reprise ici : « Nous ferons remarquer que le précieux témoignage du capitaine Delvert est le témoignage d’un soldat dont la profession avant et depuis la guerre est d’enseigner l’histoire. Ce n’est pas toujours une garantie de probité historique. André Fribourg, agrégé d’histoire qui avait écrit avant la guerre un mémoire sur la psychologie du témoignage en histoire, a publié de pseudo-souvenirs de guerre que l’on a classés parmi les meilleurs livres de combattants, tromperie que je suis le seul à signaler, je crois. Mais lorsqu’un esprit est probe et qu’il a acquis une riche expérience de la guerre des combattants, c’est pour lui un privilège et une aide d’avoir étudié la technique de l’histoire, d’avoir pu, en la mettant à la portée des élèves, en mesurer les insuffisances et les aventureuses affirmations. En faisant la guerre Delvert pense à l’histoire ; il termine une de ses observations psychologiques par cette admonition : « Avis aux futurs historiens de la guerre ». »
Des historiens bons ou mauvais témoins
Que reproche précisément JNC à Croire. Histoire d’un soldat, le livre d’André Fribourg paru en décembre 1917 chez Payot ? « Voici un livre dont on a beaucoup trop parlé, les historiens comme les critiques littéraires, et qui mérite bien peu les éloges qu’on lui a décernés. Il est à peu près vide, ce qui n’a rien d’étonnant quand on songe que l’auteur a été évacué après dix jours de front. Fribourg a eu le tort de vouloir faire une œuvre avec cette maigre expérience. » Il a dû compenser en introduisant des éléments de fiction.
De la fiction aussi dans L’assaut repoussé de Louis Gillet (1919), normalien et agrégé d’histoire, officier d’état-major : « Le livre de Gillet nous montre quelle déformation de la bataille de Verdun peut exister dans l’esprit d’un officier de l’Armée de Verdun dont l’expérience personnelle a été limitée à la zone que n’atteignaient pas les obus. »
Le cas du chartiste Augustin Cochin est un peu différent. Il a connu les tranchées et les combats et a été tué en juillet 1916. Mais son séjour sur le front a été entrecoupé de longues périodes de soins et de convalescence. Nationaliste, il qualifie les Allemands de « race d’ilotes et d’esclaves », « affreuse, affreuse race », des animaux ignobles… JNC précise : « Ce nationaliste militant n’avait pas rompu avec les idées de l’arrière, il n’avait pas pu. Ses blessures consécutives l’avaient chaque fois renvoyé faire un long séjour parmi des gens qui entretenaient en lui les préjugés nationalistes les plus absurdes. » Georges Girard était lui aussi archiviste paléographe. Son roman Les vainqueurs (1925) contient quelques passages justes, mais ressemble à « un bon devoir d’élève, bien écrit, inspiré de lectures variées assez bien assimilées ». Assez loin, donc, d’un témoignage direct.
Licencié en histoire, docteur ès lettres en 1913, Pierre Ladoué a publié Ceux de Là-Haut chez Perrin en juillet 1917. Son livre a été primé par l’Académie française. JNC remarque : « Il faut croire qu’elle ignorait l’existence d’une foule de livres de combattants qui méritaient bien mieux cette récompense par la valeur de leur témoignage comme par l’intérêt de leurs récits. » Un passage de Ladoué nous interpelle : « Je sais des professeurs de Sorbonne qui ne survivront pas au cataclysme. Je veux dire en tant que professeurs. Il est avéré d’ores et déjà que leur idéal a fait faillite. Mort est leur crédit. La recherche fanatique du document, les fiches, les fiches, les fiches… on sera revenu de tout cela après la signature de la paix. » « Quelle étrange prophétie ! », commente JNC. Il ajoute que c’est justement grâce à ses fiches qu’il a pu comparer la faiblesse du témoignage de Ladoué sur la butte de Vauquois à celui, excellent, d’un autre historien combattant, André Pézard.
Celui-ci est classé en première catégorie, Ladoué en cinquième. On a déjà évoqué le témoignage de Pézard, de même que celui de Daniel Mornet, également de premier choix. On pourrait ajouter le solide témoignage du professeur d’histoire Septime Gorceix, publié seulement en 1930 sous le titre Évadé, et donc hors du corpus de JNC, mais présenté sur le site du CRID 14-18.
Deux enfants futurs historiens
Ils n’étaient évidemment pas combattants, mais ils ont vécu l’événement et sont devenus historiens. Henri Grimal avait 4 ans en 1914, Henri Michel en avait 7. Tous deux ont publié bien plus tard leurs souvenirs d’enfance, Grimal en 2005, Michel en 2012. Depuis la guerre, ils avaient acquis les méthodes de l’histoire, ce qui leur a permis de mieux interpréter les faits dont ils se souvenaient et de les replacer dans l’évolution générale des campagnes aveyronnaises (Grimal) et du bourg provençal de Vidauban (Michel). Un exemple significatif tiré du livre d’Henri Michel concerne l’arrivée des permissionnaires : « Ce qu’ils décrivaient n’avait pas grand-chose à voir avec ce que les journaux racontaient. » Alors, les gens de l’arrière leur expliquaient « la vérité des choses de la guerre » qu’ils connaissaient mieux. Et l’historien de noter : « À nous revoir leur faire la leçon, je suis étonné aujourd’hui encore qu’aucun permissionnaire ne nous ait jeté au visage son mépris et sa colère. » Une réflexion d’historien adulte sur le témoignage d’un enfant de 1915-1916.
Ouvrages utilisés :
– Philippe Lejeune, « Nous autres à Vauquois (1918) d’André Pézard : l’après-coup de la guerre », dans Écrire en guerre, 1914-1918, Des archives privées aux usages publics, sous la direction de Philippe Henwood et Paule René-Bazin, Rennes, PUR, 2016.
– André Kaspi, Jules Isaac, Paris, Plon, 2002.
– Rémy Cazals, « Les versions successives du Malet-Isaac », dans Enseigner la Grande Guerre, Portet-sur-Garonne, Éditions midi-pyrénéennes, 2018.
– André Ducasse, La guerre racontée par les combattants, Anthologie des écrivains du front (1914-1918), Paris, Flammarion, 1932, 2 tomes.
– Olivier Dumoulin, Marc Bloch, Presses de Sciences Po, 2000.
– Rémy Cazals, « 1959 : le retour aux vérités des combattants », dans Le Monde, « 14-18, le journal du Centenaire », 13 mai 1914 (à propos du livre de Ducasse, Meyer et Perreux).
Sources :
– Dans Témoins, notices Werth, Pézard, Meyer, Delvert, Fribourg, Gillet, Cochin, Girard, Ladoué, Mornet.
– Dans 500 témoins, notices Rouvière, Pierrefeu, Carrias, Isaac, Bloch, Pomiro, Grimal, Michel.
– Sur le site du CRID, notice Gorceix.
2. Historiens non combattants et témoignages
Pendant la guerre, des historiens étaient trop âgés pour être mobilisés ; après la guerre, sont venues de nouvelles générations d’historiens qui ne l’ont pas vécue. Comment ont-ils considéré les témoins ?
Participer à la guerre par la propagande patriotique
Rédacteur de la Revue des Deux Mondes, Victor Giraud a écrit une Histoire de la Grande Guerre en 1919, avertissant clairement ses lecteurs : « L’histoire n’est pas un acte moral, l’historien n’est pas au-dessus de la mêlée, il est dans la mêlée même. » Giraud s’en prend directement à Romain Rolland, auteur d’articles réunis sous le titre Au-dessus de la mêlée, et il confirme la pratique de Gabriel Hanotaux. Celui-ci, ancien ministre, estime que l’histoire qu’il raconte en même temps que la guerre se déroule doit être elle-même une arme de guerre, « une œuvre d’action et de combat ».
Jean Norton Cru a fortement critiqué Hanotaux et les historiens ayant adopté le même comportement, en particulier sur leur utilisation des témoignages : « Pour chaque histoire j’ai pu dresser un tableau des témoins cités, par ordre de fréquence de citation. Ces tableaux sont suggestifs : ils prouvent qu’aucune critique des témoignages n’a précédé leur utilisation, que les plus souvent cités sont ceux qui n’ont rien vu (Louis Gillet) ou qui racontent surtout ce qu’ils n’ont pas vu (Veaux) ou qui sont des émules de Coignet (Libermann). La raison, je l’ai donnée ailleurs : les historiens veulent des faits, le plus possible ; les narrateurs qui en donnent le plus sont toujours les absents et les hâbleurs. »
Depuis leur bureau, les historiens de cette trempe exigent des témoins la fréquente utilisation de l’arme décisive qui est pour eux la baïonnette, arme française devant laquelle tremblent les Allemands. Ils aiment les descriptions de corps à corps et les flots de sang et le cri de « Vive la France ! » avant de mourir.
Hanotaux porte un jugement sur les mutins de 1917 : « De mauvaises têtes proclament que la guerre a assez duré. » André Ducasse, authentique combattant déjà cité, lui répond : « Mauvaises têtes ! Voilà de quelle façon cavalière un écrivain qui n’a « jamais vu le feu que dans sa cheminée » (selon le mot de Clemenceau), se permet de juger des soldats, dont certains avaient fait sept ou huit attaques et devaient périr quelques jours plus tard. On aimerait parfois chez les historiens un peu plus de sens critique et de pudeur. »
Des remarques de même type pourraient s’appliquer aux historiens des autres pays belligérants. Les livres des Hanotaux constituent un témoignage sur une conception de l’histoire. Nicole Loraux disait qu’il fallait « rendre l’Histoire de Thucydide à son statut de texte pour la traiter en document sur l’écriture de l’histoire au Ve siècle ».
Trois ouvrages généraux récents
Concernant les historiens d’une période plus récente, il ne sera évidemment pas possible de les citer tous. Je prendrai seulement trois exemples d’ouvrages généraux sur la Grande Guerre : de Jean-Baptiste Duroselle (1994), de Frédéric Rousseau (1999), de Rémy Cazals et André Loez (2008).
Dans son « introduction personnelle » à son livre important La Grande Guerre des Français, Jean-Baptiste Duroselle, de l’Institut, évoque son père, combattant de 14-18. Il précise : « Ce livre n’est pas une histoire universelle de la Première Guerre mondiale, mais celle des Français face à ce cataclysme. Leurs angoisses, leurs souffrances, leur ténacité, leurs désespoirs, leur gloire finale – mais à quel prix ! » Dans sa bibliographie, il insiste sur le livre « le plus remarquable », celui de Ducasse, Meyer et Perreux, présenté plus haut dans mes réflexions. On pourrait donc s’attendre à l’utilisation de nombreux témoignages de Français « ordinaires » dans le texte de ce livre très intéressant.
Mais les deux témoins les plus cités sont le général Mordacq et le président Poincaré. Viennent ensuite 9 hommes politiques, 11 généraux, et 14 combattants situés plus bas dans la hiérarchie. Ces combattants sont deux abbés, des romanciers célèbres (Barbusse, Dorgelès, Duhamel), des intellectuels (Delvert, Galtier-Boissière, Meyer, Péguy, Pierrefeu, Péricard, Mairet, Tuffrau, Genevoix, mais pas Pézard). La bibliographie correspond à cette liste. Elle compte les mémoires de 19 chefs militaires et de 17 hommes politiques français, et 44 biographies de grands personnages parmi lesquels Foch, Weygand, Clemenceau, Poincaré, Pétain, etc. Jean Norton Cru est cité une fois. Il est regrettable que le lieu de la mort de Louis Mairet soit orthographié « Caronne » et le titre du livre de Jacques Meyer « La Gifle » au lieu de La Biffe. Publié en 1994 chez Perrin, le livre de Jean-Baptiste Duroselle ignore le témoignage de Louis Barthas, pourtant sorti seize ans plus tôt et réédité maintes fois entre 1978 et 1994.
La guerre censurée, Une histoire des combattants européens de 14-18, de Frédéric Rousseau, date de 1999. Le tonnelier Barthas est connu et largement cité. Dans l’index des noms de personnes, il revient à 59 reprises. En deuxième position se trouve Dominique Richert, « le Louis Barthas allemand », avec 55 mentions. Puis Ernst Jünger (51), Maurice Genevoix (42), Robert Graves et Emmanuel Maugat (33), Erich-Maria Remarque (32), Roland Dorgelès (31), Emilio Lussu (28), Marc Bloch (24). Sur ces dix combattants les plus cités, 5 Français, 3 Allemands, 1 Anglais et 1 Italien. Le texte du brancardier Maugat était inédit.
Le livre de 2008 de Rémy Cazals et André Loez, Dans les tranchées de 1914-1918 donne une liste de 151 témoins cités, parmi lesquels 129 poilus de l’infanterie ou du génie. 109 de ces témoignages avaient été publiés ou réédités depuis 1978, dont 58 au XXIe siècle ; 15 étaient des textes inédits, parfois retranscrits dans des mémoires de maîtrise de l’université de Toulouse-Le Mirail (aujourd’hui Jean-Jaurès).
Sur des thèmes particuliers
L’utilisation des récits des témoins dans des livres d’histoire portant sur des thèmes particuliers ou des batailles est très largement répandue. Je ne pourrai citer que quelques exemples. Sur la bataille de la Somme, vue du côté britannique : Somme, Into the Breach, par Hugh Sebag-Montefiore. Sur les relations entre soldats : Alexandre Lafon, La camaraderie au front, thèse de doctorat toulousaine publiée par Armand Colin avec le soutien du ministère de la Défense en 2014, un ministère qui a su dépasser le stade de l’histoire bataille. Sur les loisirs : Oublier l’apocalypse ? de Thierry Hardier & Jean-François Jagielski. Sur les trêves et fraternisations, le livre pionnier de Tony Ashworth (Trench Warfare 1914-1918, The Live and Let Live System, publié dès 1980) puis celui de Malcolm Brown & Shirley Seaton (Christmas Truce, édité en 1994). Le même Malcolm Brown a participé avec Marc Ferro, Rémy Cazals et Olaf Mueller à l’étude internationale Frères de tranchées (Perrin, 2005). Tous ces ouvrages donnent la parole à quantité de témoins directs. Mon livre publié par Privat en 2018, La fin du cauchemar, 11 novembre 1918, repose entièrement sur plus de cent témoignages de soldats et de civiles sur cette journée mémorable. 26 de ces témoins ont leur portrait dans le livre
Maxim Chiniakov cite de nombreux témoins dans ses ouvrages non traduits du russe, notamment Les militaires russes en France, en Afrique du Nord et aux Balkans (1917-années 1920). Dans leurs travaux sur leurs pays en guerre, Snejana Dimitrova et Dorin Stanescu font appel aux témoignages de Bulgares ou de Roumains ; Dorin a écrit des notices sur le site du CRID 14-18. En Italie, on peut évoquer les livres de Bruna Bianchi, et Giovanna Procacci. De cette dernière, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra est sous-titré Con una raccolta di lettere inedite. C’est à une réflexion sur les Lettere dalla Grande Guerra que s’est livré Fabio Caffarena dans une thèse de doctorat publiée en 2005. On a vu plus haut comment il tenait à remettre à leur place les « lettres de marbre » mises en avant par le fascisme, et à rechercher les « lettres de papier », documents authentiques. Les fonds rassemblés par l’Archivio Ligure della Scrittura Popolare de l’université de Gênes a fourni à Fabio un matériau abondant et de qualité.
Il faudrait terminer par un « etc. », qui pourrait contenir un très grand nombre de références.
Historiens présentateurs de témoignages
Il est arrivé à des historiens de détourner les témoignages et de faire servir les témoins à la défense d’une théorie préétablie. Jean Norton Cru en donne un exemple frappant avec l’utilisation des lettres et carnets d’un capitaine du 131e RI par un historien militaire : « Geoffroy de Grandmaison a voulu publier un livre sur le capitaine Pierre de Saint-Jouan dans un but d’édification patriotique. Et cela est infiniment regrettable. Ce but lui a fait perdre de vue qu’il avait en main des lettres, un carnet intime, un journal, qui contenaient la pensée et les impressions de guerre d’un poilu mort, et qui avaient une valeur intrinsèque très grande. […] Comment l’éditeur n’a-t-il pas compris qu’il usurpait la place du combattant en nous parlant de la guerre, lui qui ne peut pas la connaître ? Il ne se doute pas qu’il se couvre de ridicule car on voit bien que son ignorance est candide : il appelle les obus allemands des crapouillots, les nôtres des boulets. » Grandmaison évoque les régiments du Midi, débilités « par tout le poison démocratique ». JNC lui répond : « Que de Grandmaison s’occupe ailleurs de la politique de parti s’il veut, mais qu’il ne la mêle pas à la guerre des combattants où elle n’a rien à faire. » Le devoir de l’historien aurait été de respecter à la fois l’histoire et la mémoire du combattant « en ne prétendant pas que ce jeune homme a mal vu la guerre, tandis que lui l’a vue plus exactement de son bureau ».
Plus récemment, à partir du cas de Lucien Laby, on a vu fleurir la théorie selon laquelle les médecins étaient culpabilisés de ne pas être des combattants. Une théorie poussée jusqu’à la caricature en opposant le « centre » où l’on combat et la « périphérie » où les hommes ne peuvent être que dévalorisés. Le cas du jeune Laby, médecin auxiliaire nationaliste, convient assez bien pour illustrer cette théorie : en 14, il lui tarde de partir car il serait « vexé d’arriver à la fin de la guerre sans avoir tué un Prussien au moins » ; il va en effet dans une tranchée en novembre 1914 et tire sur l’ennemi. Mais, il faut lire aussi son aveu du 3 mai 1917 : « Quelle boucherie encore on va voir ! C’est bien fait pour moi et je n’ai pas le droit de me plaindre : je suis l’un des nombreux imbéciles qui ont poussé le chauvinisme jusqu’à souhaiter la guerre. Eh bien, je suis servi ! » Enfin, il faut remarquer qu’on ne peut pas construire l’histoire sur des affirmations à partir d’un cas. La présentation du livre de Laby affirme que « les médecins ont subi au cours du conflit une très profonde crise d’identité » et qu’il « est entendu que toute identité virile ne peut alors passer que par une participation au combat ». Les témoignages de médecins récusant cette théorie préétablie sont nombreux : Prosper Viguier, Albert Martin, Paul Voivenel, Louis Maufrais, Emmanuel Morisse, etc. Tous pensent qu’ils ont à remplir une tâche noble, celle de soigner et de tenter de sauver des vies dans des conditions extrêmement difficiles. Mais, au nom de la théorie, on est conduit à ne pas vouloir tenir compte des documents qui conduiraient à la contester.
Le témoignage du fantassin Étienne Tanty ne pouvait pas servir à illustrer la théorie du consentement des soldats à la guerre. Le titre du livre composé avec les lettres adressées à ses parents, Les violettes des tranchées, est suivi d’un sous-titre bien clair, Lettres d’un Poilu qui n’aimait pas la guerre. Et en effet, non seulement il ne l’aime pas, mais il regrette de ne pas avoir été capturé au tout début, il souhaite tirer sur les responsables français ou allemands. Faute d’invoquer le consentement, la préface d’Annette Becker reprend l’autre terme à la mode, un néologisme à partir de l’anglais « brutalization » (transformation en brute). De fait l’escouade dans laquelle échoue Tanty au 129e RI, lors de la mobilisation, est composée de malotrus insupportables pour cet intellectuel. Mais ils sont décrits comme des brutes dès le premier jour, ce n’est donc pas la guerre qui les a transformés. Et puis, si on lit le livre jusqu’à la page 553, on constate que, dans sa nouvelle affectation après une blessure, son escouade au 24e RI est formée de camarades très agréables, « de bons types ». Tanty précise que l’escouade du 129 était une exception.
Au cours de « la guerre de tranchées » entre historiens de 14-18 décrite dans Le Monde du 11 mars 2006, on a assisté à des attaques d’autant plus virulentes qu’elles étaient mal fondées. On pouvait même, emporté par son élan, commettre quelque bévue. Ainsi, au début du XXIe siècle, une réédition du témoignage d’André Pézard aurait pu se passer du pamphlet placé en postface par un professeur connu, défenseur de la théorie du consentement des combattants à la guerre. L’objectif de ses trois pages était de condamner les historiens qui estiment nécessaire de discuter les excès de cette théorie. Mais, écrite trop rapidement et non relue, la postface aboutissait à la plus complète confusion. Sans utiliser de [sic], je transcris exactement le passage : « Nous autres à Vauquois est un livre particulièrement précieux au moment où certains se sont mis en tête de faire croire à l’opinion qu’il y a deux lectures de la guerre. Celle du consentement, c’est-à-dire celle où les soldats, décrits comme truqueurs, peureux, ivrognes, obsédés sexuels et j’en passe, …, n’auraient été que les victimes de l’implacable discipline que les autorités militaires leur auraient fait subir… Dans le même esprit, on met essentiellement l’accent sur les « fusillés pour l’exemple ». » Encore une fois, je garantis l’exactitude absolue de ma transcription du texte et des différents signes de ponctuation. On aura remarqué la confusion : l’auteur voulait écrire « celle de la contrainte » et non « celle du consentement ». Il voulait condamner « certains » historiens qui sont Frédéric Rousseau et Rémy Cazals, Nicolas Offenstadt et le général André Bach. Une réédition plus récente de Nous autres à Vauquois ( La Table ronde, 2016) n’a pas retenu la postface polémique. Elle l’a heureusement remplacée par des informations intéressantes : la reproduction de la notice de Jean Norton Cru sur le livre d’André Pézard et une longue lettre de celui-ci adressée à l’auteur de Témoins. Une lettre qui souligne le caractère de guide indispensable à travers la littérature de guerre que constitue le travail de JNC.
On retrouve le même fiel et la désignation volontairement imprécise de l’adversaire intellectuel dans l’introduction de Jean-Noël Grandhomme au témoignage de Pierre Waline. Celui-ci apporte un beau texte sur les fraternisations entre soldats français et allemands. Le présentateur le commente : « Ce monde cruel connaît cependant aussi parfois des « usages » – qu’une certaine historiographie a voulu ériger en un phénomène général et récurrent : les « fraternisations » –, mais éphémères et révisables à tout moment : les longues périodes où, par accord tacite, personne ne tire ; celles où les uns et les autres sortent de la tranchée pour se dégourdir les jambes, celles même où l’on peut enfin aller chercher ses morts. « Des deux côtés, les yeux voient, mais les fusils restent muets, écrit Pierre Waline. Chacun se demande si l’adversaire rompra le premier cette trêve de misère. » » Parlant au nom de la « certaine historiographie », je remercie Pierre Waline pour avoir fourni un document supplémentaire illustrant un phénomène que j’ai moi-même décrit comme « éphémère et révisable » mais qui était constitutif de la guerre de tranchées.
D’un autre côté, il est réconfortant de constater que des historiens ont bien rempli leur mission d’historien. Présentant les carnets de guerre de son oncle Jean Daguillon, François Bluche écrit : « Si grand que soit le talent d’un écrivain, il nous instruit moins sur les mentalités du temps de guerre que le journal honnête et régulièrement tenu d’un simple combattant dépourvu de talent littéraire. » Vincent Suard, auteur de la notice « Bauchond Maurice » sur le site du CRID, signale l’intérêt de son journal de l’occupation de Valenciennes ainsi que la qualité de la préface d’Yves Le Maner et de la présentation et des nombreuses notes utiles de Philippe Guignet. L’excellent témoignage de l’instituteur Marc Delfaud, téléphoniste au 206e RI (Carnets de guerre d’un hussard noir de la République, Éditions italiques, 2009), méritait les soins éclairés de son éditeur, le général André Bach, et du préfacier Antoine Prost. Ce dernier note : « Avouons-le, la Grande Guerre nous fascine encore. Non la guerre des généraux, des diplomates ou des ministres. Savoir qui, de Joffre ou Gallieni, est le véritable vainqueur de la bataille de la Marne ne nous intéresse plus, et les questions de la mobilisation industrielle, du blocus ou du ravitaillement ne nous captivent pas davantage. Elles ne nous semblent plus essentielles et nous avons le sentiment que tout a déjà été dit, qu’il n’y a plus rien à comprendre. Nous avons sans doute tort, mais ainsi va le monde : les intérêts se sont déplacés. Ce qui accapare notre attention aujourd’hui, c’est autre chose : la vie des hommes dans la guerre. »
Enfin, voici un opuscule de 65 pages publié par les Amis du Vieux Confolens en 1999, Un Charentais dans les Balkans, Carnets de Pierre Boutant sur le front d’Orient (1915-1917). Cultivateur instruit, cet artilleur décrit la vigne en Languedoc, les labours primitifs et la moisson à la faucille dans les Balkans, le mastic de Chios et le vin de Samos, les villages et leurs minarets. Son travail consiste à s’occuper des chevaux et il nous livre des anecdotes significatives. Le présentateur, Joël Giraud, a tenu à publier l’intégralité du témoignage en avançant cette remarque judicieuse, d’un véritable historien : « Nous ignorons si nos curiosités d’aujourd’hui seront celles des historiens et des lecteurs de demain. » Il est vrai que les témoignages sur la guerre pourraient également servir de base à une étude sur l’ennui (Émile Banquet), à un panorama de la gastronomie du Gers (Maurice Faget), à un catalogue de pratiques religieuses (Joseph Charrasse). Sans doute aussi à un tour de France des pratiques agricoles concrètes, sur le terrain.
Ouvrages utilisés :
– Rémy Cazals & Frédéric Rousseau, 14-18, le cri d’une génération, Toulouse, Privat, 2001.
– « Thucydide n’est pas un collègue », dans Nicole Loraux, La Grèce hors d’elle et autres textes, Klincksieck, 2021, p. 207-221.
Sources :
– Dans Témoins, notices Gillet, Veaux, Libermann, Mairet, Meyer, Saint-Jouan, Pézard.
– Dans 500 témoins, notices Laby, Viguier, Martin, Voivenel, Maufrais, Morisse, Tanty, Waline, Daguillon, Delfaud, Boutant, Banquet, Faget.
– Sur le site du CRID, notices Bauchond, Charrasse.